A journey to Gallipoli – Terminus Gaba-Tepe
« A JOURNEY TO GALLIPOLI »
Une nouvelle de mon livre, « des poppies et des larmes »
2ème partie : Terminus, Gaba-Tépé
BATAILLE DES DARDANELLES
Du 19 février 1915 au 9 janvier 1916.
« GALLIPOLI », LE GUÊPIER OTTOMAN !
Lire : La Carrière Wellington
25 avril 1930, ANZAC DAY.
Mémorial du soldat inconnu, Cap Helles, Turquie.
Soldat ANZAC : Archibald Woodraw – 10ème bataillon d’infanterie australien.
L’homme a tenu à être seul. Il a demandé à son épouse et son enfant de rester à l’entrée du cimetière. Tel un automate, il arpente les allées fleuries séparant les stèles des soldats morts. Le silence du lieu contraste avec ses souvenirs, encore frais dans sa mémoire. Il s’appelle Archibald Woodraw. C’est ici même, le 25 avril 1915 au petit matin, qu’il fut débarqué avec ses copains Barney Wickfield et Harry Owen, sur cette petite bande de terre à flanc de falaise. C’est avec une profonde tristesse qu’il s’est recueilli sur la tombe de ses camarades. Lui seul a réchappé au massacre, à ce que les survivants ont appelé « l’enfer de Gallipoli ». Face à ce promontoire qui paraît, encore aujourd’hui, infranchissable, les stigmates de la bataille sont encore présents. Et il ne peut que constater l’évidence ; toute l’opération était vouée à l’échec.
Ils étaient tous les trois originaires de Perth. Lorsque la guerre éclata, à l’image de tous les sujets des Dominions, tous s’enrôlèrent spontanément pour aller défendre la patrie, la Grande Bretagne et le Roi. Ils quittèrent les territoires arides et la brousse d’Australie pour une aventure, disaient-ils, qui leur ferait découvrir le monde ! Ils avaient vingt ans, la tête pleine d’espérance, et comme tous les jeunes en ce temps-là, ils étaient insouciants et inconscients du danger. Ils étaient fiers de s’être enrôlés dans cette armée qui allait donner, ils ne le savaient pas encore, toutes ses lettres de noblesse au nouveau corps ainsi créé : les ANZAC. L’avenir dira que c’est de leur courage et de leur abnégation que naîtra, à Gallipoli, l’identité de l’Australie et de la Nouvelle Zélande.
Ce fut un moment incontournable de l’histoire de ces deux nations ; ce fut aussi leur première guerre.
Contrairement aux Alliés, les Ottomans n’eurent pas de nécropoles. Ils furent tous enterrés dans des fosses communes.
Alors, sur le promontoire qui surplombe les plages étroites, Archibald se souvient de ce point du jour à l’aube du 25 avril 1915.
En raison du mauvais temps et d’une mauvaise organisation, le débarquement prend deux jours de retard. Ce qui donne largement le temps aux Turcs de consolider leurs fortifications.
Gaba-Tepe à l’aube.
La côte était toute proche. La manœuvre s’effectuait dans un silence total. Il faut dire que les sons portaient loin sur les flots. Nous n’avions guère dormi ; le 10ème bataillon était pressé sur les aires des garde-corps du navire de guerre, prêts à descendre dans les chaloupes. Barney et Harry ne disaient pas un mot. Je les sentais inquiets ; qui ne l’aurait pas été ! Qu’allait-il se passer ? Il était impossible que l’ennemi ne fût pas averti de nos plans. Je le sentais, il était là, il nous attendait, il guettait sa proie comme un serpent, immobile, silencieux. La surprise ne pouvait pas jouer, nous étions attendus. En fixant du regard la côte qui semblait se dessiner face à nous dans l’obscurité, on pouvait deviner l’écume blanche du ressac sur le rivage. Elle semblait déserte, mais ce n’était qu’un leurre.
Soudain, l’officier de quart nous ordonna de monter dans les canots. C’est parti ! me dis-je. Je bondis, et me serrai instantanément contre mes deux camarades dans la frêle embarcation.
Une fois celle-ci remplie, ce fut la manœuvre de mise à l’eau. Tout s’était déroulé rapidement. Nous devions nous arrimer par quatre, puis dès qu’un train de barques était formé, une pinasse à vapeur assurait le remorquage vers la côte. Ainsi tracté, notre convoi put approcher jusqu’à cinquante mètres de la plage,tant que les fonds le permirent.
Puis à nous de ramer pour gagner la terre ferme…
Le général Sir William Birdwood, qui commande les ANZAC, prévoit ce matin-là de déverser initialement 4000 hommes sur la côte turque. Trois vagues d’assaut successives sont déployées sur une distance qui s’étendra sur environ deux kilomètres.
Tout autour de nous des canots bondés d’hommes essayaient de se stabiliser. Avec un tel rassemblement de soldats et de matériel, il était devenu impossible d’être silencieux. Des éclats de voix se faisaient entendre, et leurs échos nous revenaient après avoir pris appui sur les falaises toutes proches. Loin devant, la première vague, qui avait environ vingt minutes d’avance sur nous, était sur le point d’accoster. C’est alors que nous comprîmes que rien ne s’était passé
comme prévu. Nous avions été largués trop au nord des plages envisagées initialement, et le terrain qui se découvrait sous nos yeux dévoilait un promontoire escarpé, couronné par les fortifications d’Ari Burnu quasi infranchissables.
C’est alors qu’un feu d’enfer se déchaîna sur les unités qui venaient de prendre pied sur la terre ferme ! Les hommes bondirent en désordre hors des canots, en tâtonnant et en trébuchant sur tous les obstacles hérissés par les défenseurs turcs. Les balles des mitrailleuses sifflaient autour d’eux ; certains se jetaient à l’eau pour échapper à cette pluie d’acier. Nombreux furent ceux qui ne purent faire un pas en terre ennemie ; leurs corps, ondoyant dans le ressac, étaient bercés sans relâche sur le bord de la plage.
Lorsque ce fut notre tour, un grand nombre de canots surchargés en hommes furent touchés par l’artillerie ottomane. Les gerbes d’eau ainsi soulevées en avaient fait chavirer un certain nombre sous nos yeux horrifiés ! Les hommes, surchargés en équipement lourd, coulaient à pic et se noyaient sans que nous puissions esquisser le moindre geste. Les éclats d’obus transperçaient les coquilles de noix qui nous transportaient et nous rendaient vulnérables comme de simples fétus de paille.
Un projectile de gros calibre fit voler en éclat le chaland qui nous tractait. Celui-ci s’embrasa presque instantanément, et l’équipage, dont certains des membres avaient le corps en feu, se jeta à l’eau désespérément. Avec l’énergie du désespoir, nous rompîmes le cordon ombilical qui nous reliait pour ne pas être entraînés avec lui dans les abysses. C’est à la rame et à force de bras que nous continuâmes notre cap ! Le jour commençait à se lever, et le spectacle qui s’offrait à nos yeux était effrayant. Face à nous, les pentes escarpées du promontoire nous fascinaient par le cauchemar d’une vision apocalyptique. Aux pieds de cette muraille gisait le désastre d’une armée incapable d’avancer, clouée sur place. Le bord de mer était devenu rouge du sang de tous ces malheureux criblés de projectiles. J’arrivai avec la deuxième vague, sans trop savoir quoi faire, et me propulsai d’un bond hors de ce frêle esquif qui avait pourtant résisté à la tourmente. Je me trouvais dans un état comateux. Et sans trop réfléchir, je me précipitai dans une lutte sans merci contre la mort. Je me mis à courir droit devant afin de trouver un abri parmi les rochers. Dans ma course effrénée, je trébuchai çà et là sur les corps sans vie de mes camarades étendus sur le sable. Les balles sifflaient près de mes oreilles ! Quelques secondes à peine s’étaient écoulées, mais elles me parurent une éternité. Ce fut avec un profond soulagement que je découvris que Barney et Harry avaient survécu. Désemparés, ils se blottissaient avec d’autres soldats contre les rochers, au bas de la falaise. Les tirs courbes de l’artillerie ennemie étaient alors devenus inefficaces contre l’aplomb de la paroi.
Ce qui restait des hommes de la première vague se mirent à escalader les pentes abruptes de la crique, ne laissant aucun répit à l’ennemi ; ils arrivèrent à consolider une ligne de feu. La première ligne de défense turque fut abordée, et ses défenseurs furent décimés à la baïonnette. Nous étions à quelques mètres derrière eux en soutien pour finir le travail. Quelques uns se rendirent les bras levés, en espérant avoir la vie sauve ; ils nous demandaient de les épargner de la mort…
Un fort ressentiment commençait à poindre envers ces Ottomans que nous ne connaissions pas. Et ce fut sous des jurons et autres insultes, traités de « bastards » (salauds), qu’ils partirent en captivité. C’est la loi de la guerre, tuer pour ne pas être tué. Pourtant, ces glorieux et farouches combattants de la Sublime Porte ne faisaient que défendre le sol de leur patrie, face à une redoutable armée d’invasion. Devait-on les haïr pour autant ?
Les Turcs, submergés par le nombre, refluèrent en désordre, nous laissant par la même occasion un grand nombre de prisonniers blessés. Cette retraite permit le débarquement d’autres troupes de renfort, mais cette fois sans pertes. Vers les six heures du matin, j’abordai la pointe de la première des trois collines que nous avions prise de haute volée, puis la seconde fut enlevée, et une heure plus tard, les sections les plus avancées atteignaient le sommet de la troisième ! Il y avait maintenant 4000 ANZAC dans une bataille qui s’annonçait sous les meilleurs auspices. Nous nous étions enfoncés de trois kilomètres en territoire ennemi, certes, mais cette tête de pont demeurait précaire. En ligne de mire, j’apercevais devant moi les fantassins de notre armée qui pressaient leur avance. Ne voulant laisser aucune initiative à l’ennemi qui reculait, en désordre, vers les retranchements de réserve de l’ouvrage fortifié du Chunuk Bair, ils gravissaient les escarpements comme des alpinistes chevronnés. Nous étions facilement reconnaissables avec nos légendaires chapeaux de brousse, le Slouch-hat. Et l’on pouvait discerner aisément notre uniforme kaki des capotes ottomanes sombres et foncées, coiffées de leur kabalac.
– Le chapeau traditionnel, « bush-hat » ou « Slouch-hat ». – La tunique, modèle 1902. – Le pantalon, modèle 1902. – Équipement et cartouchière en cuir, modèle 1902. – Une Gourde à bouchon en bois. – Une baïonnette. – Un poignard « Push Dagger ». – Un fusil « Smle MK III ». – Une paire de chaussures à œillets et crochets. – Une paire de bandes molletières. – Une musette en toile, modèle britannique. – Un sac à fixations dorsales. – Une paire de jambières en cuir. Faute d’approvisionnement suffisant, il faudra attendre 1916 pour que l’armée ANZAC soit dotée du casque en acier britannique, le « Brodie Mark I » (bataille de Fromelles, juillet 1916).
Nos abris, creusés à la hâte en quelques heures à peine, n’étaient pas vraiment éloignés de leurs tranchées ; un homme vigoureux pouvait leur balancer des grenades uniquement à la force des bras !
Mais les Turcs tenaient toujours les hauteurs, et il leur était plus facile de nous canarder d’en haut. Ils avaient l’avantage du terrain. La lutte s’avérait inégale, et ils le savaient ! Ce qui occasionnait une pluie de jurons des deux côtés. Les traiter à longueur de temps de « bastards » était notre injure préférée ; ils finirent par croire que c’était le nom de l’un de nos Dieux ! D’ailleurs, nous en eûmes la confirmation lors des interrogatoires de prisonniers. Il n’était pas rare de les voir montrer le ciel du doigt en disant d’une voix apeurée : « Bastard !» alors que nous étions incapables de discerner une de leurs paroles. C’était, pour un descendant Celte, une langue difficile à comprendre, toutes leurs paroles pouvaient être des insultes ! Mais nous n’étions pas en reste, aux cris de : « La Ilaha Illa Allah », nous répondions par des hurlements et des insultes en bon anglais.
Le spectacle qui s’offrait à nos yeux était effroyable. En bas, sur le bord des plages, les bateaux continuaient de déverser les troupes, les animaux, le matériel,
l’artillerie, les munitions et les vivres… Au milieu de cette cacophonie, la brigade néo-zélandaise de soutien fut débarquée pour donner plus de puissance à l’attaque australienne. Ce fut un chaos sans précédent ! Le désordre était à son comble ; les canots, bondés d’hommes qui effectuaient la navette, étaient mitraillés en permanence par les tirs plongeants des armes automatiques ennemies. De plus, les blessés commençaient à affluer, et devant ce chassé-croisé, il fut pratiquement impossible de les évacuer vers les navires hôpitaux. Beaucoup mouraient sur des civières improvisées, seuls, faute de soins immédiats. Les malheureux gisaient parmi les fourniments de soldats abandonnés à la hâte, les caisses d’explosifs, de nourriture… Le bord de mer avait pris la couleur des coquelicots, rouge sang.
Les efforts des soldats turcs pour arrêter l’invasion ont atteint leurs limites. Les obus et les cartouches commencent à manquer, leur résistance s’affaiblit de minute en minute. C’est alors qu’un jeune général turc entre de plein pied dans l’Histoire. A la suite d’une marche forcée sur les sentiers rocailleux de la péninsule, le jeune Kemal Pacha, à la tête d’un régiment de la 19ème DI, réorganise la défense. Après avoir rattrapé les fuyards qui ont cessé la lutte, faute de munitions, il ordonne une contre-attaque à la baïonnette. C’est ce jour-là qu’il dira à ses troupes : « Je ne vous demande pas de vous battre, mais de mourir. » Pendant trois jours, Mustafa Kemal s’efforcera de rejeter les Australiens et les Néo-Zélandais à la mer.
Les ordres d’Hamilton sont concis : « Vous avez accompli le plus difficile, maintenant il vous faut creuser, creuser, creuser jusqu’à ce que vous soyez en sécurité. » Commence alors pour les deux camps l’Enfer de Gallipoli. Et ils vont creuser !
CAP HELLES, AU MÊME MOMENT.
Extrémité de la péninsule : Château d’Europe à Sedd-ul-Bahr, au pied du mont Achi-Baba. Probablement informés sur les difficultés rencontrées par les ANZAC, les Alliés modifient leurs plans d’attaque. Le débarquement se fera sur cinq plages bien distinctes : S, V, W, X et Y. Les Britanniques prévoient d’échouer volontairement un vieux charbonnier, le River Clyde, et 2000 hommes de la 29ème DI, sur les plages V et W. A son bord, des fusiliers de Dublin, de Munster, et un régiment du Hampshire. Deux allèges de transbordements assureront la mise à terre des soldats. L’opération sera précédée d’un violent bombardement naval, tiré depuis les cuirassés de l’escadre sur Sedd-ul-Bahr. Malheureusement le mauvais temps retarde l’échouage du vieux bateau, et c’est sous une pluie dévastatrice de projectiles de tous calibres que le débarquement a lieu. Les défenseurs turcs ont eu le temps de regagner leurs positions après la canonnade. Les Français, qui ont réussi à progresser à Koum Kalé, sur la côte asiatique, sont, de facto, rappelés pour renforcer le flanc droit de l’attaque britannique. Erreur tactique ! En libérant la place, les Alliés vont permettre aux Ottomans l’installation de grosses pièces d’artillerie. Cette menace pèsera lourdement, jusqu’à la fin de la campagne, sur les troupes d’invasion franco-britanniques déployées autour du Château d’Europe, au Cap Helles.
KOUM KALE, LE LENDEMAIN.
Ferdinand Lambert et Georges Dunant qui, avec le CEO, ont été de l’expédition sur la côte asiatique, sont rappelés pour soutenir l’effort principal sur la presqu’île de Gallipoli.
Nous étions désorientés. Nous avions réussi à nous stabiliser sur notre objectif, au prix de pertes assez sévères, et voilà qu’on nous obligeait à nous replier ; c’était à ne plus rien comprendre. Nous avions fait fuir l’ennemi à la force des baïonnettes, investi le Château d’Asie, et élargi la ligne de front de notre tête de pont. Ces choses-là me dépassaient ; mais je n’étais qu’un soldat, et je devais obtempérer.
La traversée du chenal fut de courte durée, et déjà nous pouvions apercevoir au loin les affres de la bataille. Le fracas des armes nous parvenait dans un grondement sourd. Les canons de la flotte de guerre vomissaient leur gangue mortelle sur les contreforts de Sedd-ul-Bahr. A nos côtés, nous avions des régiments de tirailleurs sénégalais effarés. Ils étaient pourtant des combattants courageux, d’une bravoure à toute épreuve. Précédés de leurs chefs, ils pouvaient, le poignard entre les dents, emporter dans leur fougue n’importe quelle position ennemie. Ce qu’ils firent à Koum Kalé !
Notre débarquement sur les plages V et W fut un véritable cauchemar. Nous avions rejoint le gros des forces d’invasion sur cette mince bande de terre. Et c’est, une fois de plus, sous un feu nourri et la mitraille ennemie que nous fûmes accueillis ! Il y avait là un enchevêtrement ahurissant de matériel abandonné par précipitation. Les morts et les blessés par centaines qui n’avaient pu, faute de temps, être évacués, gisaient à l’endroit même où ils avaient été fauchés. C’est au prix d’efforts surhumains que nous arrivâmes à nous engouffrer dans ce désordre, et rejoindre un refuge précaire à l’abri des balles turques, l’aplomb de la falaise n’autorisant pas le tir de leurs armes automatiques. Les survivants des unités britanniques, qui se situaient devant nous, tentaient de déborder les premières lignes de défenses ennemies. Finalement, avec notre soutien et celui de quelques soldats d’unités égarées, une fois de plus, la position fut enlevée à la force des baïonnettes.
Heureusement, la couleur bleue de nos uniformes nous permettait de nous repérer de loin. Ainsi, nous avions plus de facilité que nos alliés à nous regrouper dans cet univers kaki. Pour les survivants du désastre, ce furent des jours terribles. La mort nous guettait au coin de chaque rocher. Il nous fallut deux jours pour gravir le promontoire sous un feu meurtrier ! Le guerrier ottoman avait reculé jusqu’au sommet du mont Achi Baba, et la prise de la ville de Krithia n’était plus qu’une question de temps. A chaque pas un cadavre se dévoilait sous nos yeux. Les blessés qui pouvaient se traîner, bien souvent à la force des bras, refluaient par leurs propres moyens pour chercher du secours. La désorganisation devenait totale, et une grande confusion régnait. Je fus frappé de stupéfaction, lors de l’assaut, de voir des soldats anglais arrêter leur progression pour faire du thé !!!
Bien entendu, nous n’avions pas l’avantage du terrain : l’ennemi avait les hauteurs, et il lui était plus facile de défendre ses fortifications. Pire, notre ravitaillement était continuellement bombardé. Les bateaux ne pouvaient plus s’approcher des côtes sans se recevoir illico une « volée de
plomb » ; les artilleurs turcs excellaient dans ce domaine. Par la suite, nous dûmes débarquer les approvisionnements uniquement la nuit. D’ailleurs, tout un microcosme d’organisation se mit en place dans le noir, avec pour seul éclairage la lumière des étoiles.
La décision d’exécuter toutes nos manœuvres la nuit fut prise presque aussitôt, et les Ottomans eurent la surprise de découvrir, tous les matins, des plages désertées, vides de soldats.
Le chaos était indescriptible, tant l’encombrement des plages était grand. Des monticules de matériel de toutes sortes jonchaient le sable : des caissons de munitions, de conserves, de biscuits etc.… Les services sanitaires étaient débordés. On ne pouvait pas évacuer les blessés gravement atteints sur les navires hôpitaux spécialement affrétés. Beaucoup étaient soignés sur place avec des moyens de fortune, dans une hygiène déplorable ; beaucoup allaient périr…
Je me faufilais dans cette masse hétéroclite sans trop de mal. Et heureusement, grâce à ma mère, je parlais un peu la langue de Shakespeare, ce qui me permit plus d’une fois de me débrouiller, bien souvent pour faire du troc. Notre pinard était très apprécié par les British ! Les semaines passèrent ainsi, entre deux pilonnages d’un camp à l’autre.
Comble de l’humour outre-manche, les Anglais s’adonnaient à leur sport favori : le football. Parfois, juste pour gâcher la fête, les Turcs faisaient parler la poudre ; alors les matches étaient entrecoupés par les déflagrations d’obus, qui soulevaient des gerbes de sable et d’objets de toutes sortes. Et, conséquence immédiate, les jurons pleuvaient à nouveau ! Une fois le bombardement terminé, le jeu reprenait aussitôt, puis tout le monde regagnait le « casse pipes. »
Nos lignes de défense serpentaient suivant le bon gré du terrain. Parfois, la tranchée s’arrêtait net. Un court passage à découvert offrait aux mitrailleurs d’en face l’opportunité de s’exercer, et, si possible, de faire un carton lorsque l’occasion se présentait. Il fallait être rapide pour surprendre le valeureux guerrier adverse qui était tout le temps à l’affût. Beaucoup de paris étaient pris par défi, et bon nombre de jeunes soldats y perdirent la vie. Des milliers d’hommes s’agrippaient aux pentes du promontoire ; chacun y avait fait son trou. C’était la meilleure façon de se protéger. Des dizaines de panneaux signalétiques, de tous genres et de toute espèce, avaient vu le jour. Lorsqu’on se dirigeait en secteur britannique, une pancarte annonçait : « Rosbeef », puis à l’inverse, lorsqu’on retournait en secteur français, on pouvait lire sur une autre plaque : « Froggy ». C’était à celui qui avait les textes les plus drôles. Les Anglais, je dois l’avouer, n’avaient dans ce domaine rien à nous envier. Ils étaient nantis d’un humour mordant, dénotant un moral à toute épreuve.
Lorsque les cavités n’offraient plus de protection, et qu’il fallait à tout prix passer, il y avait un écriteau surplombant le parapet qui annonçait : « abandon hope past this point ! » ou alors : « Want a free trip to England ? Stick your head up here. » Le ton était sarcastique, certes, mais c’était un grand défi à l’encontre de la mort.
Le grand foutoir était toujours d’actualité ; nous n’avions pas assez d’espace pour nous ébattre. Il faut dire que le terrain conquis était minuscule, au grand désespoir de l’Amirauté. Des tonnes de vivres et de matériel avaient été entreposées n’importe où et nous encombraient. Mais nous étions les rois du système D, la débrouillardise demeurait notre point fort. Un héritage de la culture française datant des campagnes napoléoniennes, où les Grognards, en manque de nourriture, se servaient sur les populations conquises. C’était mon analyse personnelle ! Ici, il n’y avait qu’à se servir. Nos baraquements tenaient plus du bidonville que d’un campement militaire en règle. Ils étaient constitués de planches, de toiles de tente, de poutres arrachées dans les ruines des villages bombardés des environs. Tout était bon pour s’abriter de la mitraille et pour se protéger de la poussière, du soleil, du vent, de la pluie et des insectes…
Une grande partie de ces cargaisons, jetée à la va vite, était gaspillée. Des tas d’objets flottaient sur le rivage, et les vagues, ourlées par le ressac, maintenaient cet amalgame hétéroclite ondoyant, plaqué sur le bord de mer. Des caissons éventrés de biscuits de la marque : « Huntley and Palmers », des conserves de l’enseigne : « Black Horse », de « corned beef », de confitures, des boîtes de savons « quarter dozen de Cuticura soap », et bien d’autres choses encore en provenance des antipodes.
A cela venait se rajouter le va-et-vient incessant des navettes qui transportaient l’eau potable, les infirmiers, les médicaments, les chevaux, les bêtes de somme… Un embouteillage permanent empêchait toutes les communications vers l’intérieur. Ce qui compliquait tous les mouvements, comme les transports des blessés ou les évacuations des morts. Bien entendu, les Turcs profitaient de l’aubaine et nous expédiaient par intermittence des chapelets d’obus. Du haut du promontoire, ils avaient une vue plongeante sur nous, ce qui leur facilitait bien les choses.
Ce soir-là, je fus désigné, avec un petit groupe de soldats, pour aller au ravitaillement d’eau potable. Nous avions, pour permettre plus d’amplitude à nos mouvements, sanglé nos bidons sur le dos. Il était périlleux de circuler au milieu de tout ce fatras, le long des pentes raides, des collines aux sentiers rocailleux, sans pouvoir s’agripper avec les mains. Sur le chemin du retour, je fus saisi d’admiration et de stupeur à la fois : dans mon champ de vision se dressaient les falaises du mont Achi Babha. Des milliers de points lumineux flanqués dans la roche scintillaient dans l’obscurité. Ils révélaient chacun une cache, un trou, une excavation, un abri pour un de nos soldats. C’était un tableau magnifique. Gallipoli était devenue, en cet instant, la plus grande capitale des villes troglodytiques de la planète ! Du moins le pensais-je.
Du haut des têtes de pont, mes camarades, Georges et moi-même vivions des moments dramatiques. Ces torpillages étaient parfaitement visibles et soulevaient une intense émotion. Je voyais certains soldats, abasourdis par la scène qui venait de se produire, se signer, et prier le seigneur pour l’âme de tous ces malheureux, engloutis dans les abîmes. Alors, la bataille cessait, Turcs et Franco-britanniques sortaient des tranchées : une pause ; et un quart d’heure après, le combat reprenait.
Un petit malin du corps ANZAC avait inventé un fusil à périscope, ce qui nous permettait de tirer sur notre ennemi sans s’exposer au-dessus de la tranchée. L’idée était bonne mais présentait des difficultés. Le nivellement du terrain, et sa pente en notre défaveur, rendaient sa précision aléatoire. L’adversaire avait toujours un temps d’avance sur nous.
– Un chapeau « Lemon squeezer » avec bandeau rouge d’infanterie et insigne réglementaire. – Tenue veste et pantalon, modèle 1902, de fabrication néo-zélandaise, avec titre d’épaule NZR (New Zealand Rifles) et boutons New-Zealand. – Bidon avec bouchon en bois et système particulier de fixation de la housse protectrice en feutre. – Un fusil Lee-Enfield Mark III. – Un pistolet lance-fusée et son étui en cuir. – Une musette web avec marquage NZ. – Une paire de chaussures. – Une paire de bandes molletières.
Ce matin-là, j’avais reçu une lettre de mes parents. Elle avait transité par Bizerte. Le tampon de la poste était illisible, mais je supposais qu’il y avait déjà un bon bout de temps qu’elle bourlinguait !
D’ailleurs l’enveloppe avait été ouverte, et la censure y avait glissé son nez fouineur. Mais au premier coup d’œil, l’écriture n’avait pas trop souffert. Le texte était largement compréhensible.
Cher Ferdy,
Nous avons bien reçu ta lettre du 12 avril, et nous sommes heureux ta mère et moi de te savoir en bonne santé. Nous avons un mauvais pressentiment de te savoir si loin. Je suis bien placé, au journal, pour avoir des nouvelles fraîches d’Orient, et les derniers échos ne sont pas très bons. Nous nous doutons, avec maman, que si tu te trouves aujourd’hui à Bizerte, ce n’est pas un hasard. Les évènements sur la presqu’île de Gallipoli y sont pour quelque chose. Les dépêches que nous recevons au compte-goutte de cet endroit ne sont pas faites pour nous réconforter, aussi, vois-tu, n’attends pas pour nous rassurer, car ton silence depuis toutes ces semaines nous inquiète. Ici en France, la guerre a pris une accablante tournure, et je crois bien qu’elle va s’éterniser pour notre plus grand malheur.
Je t’embrasse très fort, et je pense beaucoup à toi mon fils. Sache que si je le pouvais, je n’hésiterais pas une seconde, j’échangerais volontiers ma place contre la tienne. Je laisse la suite pour ta mère qui s’impatiente, elle veut aussi t’écrire quelques lignes.
Papa.
Mon cher Ferdy,
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai lu ta lettre. Papa vient de te décrire en quelques lignes l’anxiété qui nous mine de te savoir à des milliers de kilomètres dans ce pays inconnu. Ici en France, de terribles nouvelles nous parviennent du front. Et je prie le seigneur tous les jours pour que tu ne vives pas le même cauchemar, et qu’Il te laisse la vie sauve. Ton cousin Trevor, le fils de ma sœur Martha, n’a plus donné de ses nouvelles lui non plus depuis des jours. Elle est rongée d’inquiétude. Tous les jeunes gens du club de football de Conon Bridge dans lequel il jouait se sont engagés ensemble. Et aucune des mères n’a reçu ni courrier, ni télégramme à ce jour. Je t’en supplie mon petit chéri, écris-nous vite, nous sommes impatients de te lire. Je t’embrasse très fort.
Mum.
Je passai le restant de la matinée à rédiger une lettre de réconfort à mes parents. Il n’y avait pourtant que quatre semaines que je me trouvais sur le sol turc, et je n’avais pas vu passer le temps. Nul doute que pour eux, l’attente avait dû être interminable. Je m’obligeais à écrire des lignes tranquillisantes, à cacher l’horrible vérité, et ne donnais que des nouvelles succinctes de notre condition et de mon état de santé. D’ailleurs, la lettre serait lue par la censure ; mon intérêt était donc avant tout de les rassurer pour qu’ils sachent que j’étais toujours vivant ! Ce que je fis.
Nous étions constamment sous la menace de l’artillerie, et les marmites pleuvaient dru comme grêle. A chaque explosion, il fallait se prémunir non seulement des éclats, mais aussi de toute cette pierraille qui s’abattait sur nos crânes. Les billes des shrapnels flagellaient la croûte durcie des parois de nos abris dans un concert démoniaque. Nous n’avions aucun répit ! Il commençait à faire très chaud, et le manque d’eau devenait dramatique. Les colonnes d’approvisionnement étaient en permanence la cible des obusiers, et rares étaient celles qui arrivaient à se frayer un passage avec tout leur impedimenta.
Avec l’arrivée de l’automne et de l’hiver, les soldats seront tous équipés en bleu horizon. Le casque Adrian n’apparaîtra pas aux Dardanelles. Il arrivera en France en septembre 1915 ; les offensives auront alors cessé sur la péninsule.
Les combats continuaient. C’était l’impasse. Nous recevions des renforts, nous contre- attaquions, les Turcs nous repoussaient, puis c’étaient eux qui passaient à l’offensive, et nous les décimions à notre tour.
Les morts et les blessés s’entassaient. Chaque fois qu’il nous était possible d’en sauver un, nous prenions des risques insensés pour le rapatrier vers nos lignes. Très souvent, pour leur porter secours, de valeureux gars se faisaient descendre.
C’est alors que je m’aperçus que je n’avais plus eu de nouvelles de Georges. Où était-il ? J’arpentai notre tranchée, non sans difficulté. Elle était si encombrée de soldats que toute progression devenait impossible. La bousculade était intense, tous s’attendaient à une nouvelle charge des Ottomans. De toutes manières, chaque poste de combat était le nôtre, et je me dis que n’importe où se trouvait le mien. Georges avait dû avoir le même raisonnement, ça ne faisait aucun doute !
Ce n’est que bien plus tard que j’appris la mort de mon copain. Il avait été atteint par une balle d’arme automatique en pleine poitrine. Un infirmier avait pris la peine de me faire parvenir son livre. Ce que je croyais être un journal personnel n’était en fait qu’une bible. Ainsi, Dieu partageait ses pensées ! Avait-il songé, au moment de son dernier souffle, que cette protection divine ne l’avait pas épargné de la mort ? Ici, notre seule protection, c’était la présence de nos camarades, ceux-là mêmes qui enduraient le même sort, les mêmes privations.
Et vous pouvez me croire, il n’était pas du tout enviable. Nous vivions en compagnie de la mort !
Avec l’été qui arrivait, le statu quo qui paralysait les deux armées, la chaleur amena son lot de calamités. Les gars devaient faire face à des misères quotidiennes terribles : l’absence d’ombre, les poux, les insectes, les rats, et surtout la dysenterie, qui allait être la cause d’importants décès chez les deux belligérants. A cela venait s’ajouter le manque d’eau potable, et il n’y avait rien de pire que la soif. Et il était impossible de s’enterrer dans un terrain rocailleux, recouvert de cadavres en décomposition.
Sur tout le front, le long de la péninsule, de Gaba-Tépé jusqu’à Sedd-ul-Bahr au Cap Hélles, les deux armées sont bloquées.
SUVLA BAY, 6 AOÛT 1915.
La majeure partie de la force britannique d’assaut reposait sur la 4ème brigade australienne du général John Monash (elle comprenait également des troupes indiennes, néo-zélandaises, irlandaises, et britanniques).
Le désastre est si grand, l’échec si grave, qu’il va provoquer un véritable séisme politico-militaire. Chez nos alliés, les British, des têtes vont tomber. Fisher démissionnera et Winston Churchill, principal protagoniste du plan de bataille, connaîtra la disgrâce. Impressionnée par les événements concernant le théâtre des Dardanelles, la Bulgarie, qui était jusqu’alors indécise, entrera à son tour dans le conflit aux côtés des Empires Centraux. Le 14 octobre 1915, elle déclarera la guerre à la Serbie.
Le 1er octobre 1915, deux divisions, une britannique et une française, quittent les Dardanelles pour Salonique, au chevet de la malheureuse Serbie.
Le 5 Octobre, les premiers éléments du corps expéditionnaire débarquent à Salonique et forment l’armée d’Orient. Ferdinand Lambert se trouve dans le contingent à bord du paquebot Gaule. Archibald Woodraw arrive, lui, le même jour, à bord du Britannia.
Ils ont tous les deux connu l’enfer sur terre. Une terre gorgée de sang de couleur ocre, celle des promontoires et des falaises de cette maudite presqu’île où tant de leurs compagnons y ont laissé leur vie. Une nouvelle destination se profile sous leurs yeux. Ces jeunes hommes, à peine sortis de l’enfance, ont déjà vu tant d’horreurs. Ce nouvel horizon, c’est Salonique. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont y rester un bon bout de temps. Et en 1918, pour l’armistice, ils seront, tous les deux, aux portes de l’Allemagne.
Les fusils goutte à goutte (ou pop off) étaient des fusils automatiques utilisés à Gallipoli pour tromper les Turcs lors de l’évacuation de décembre 1915. Le 29 décembre débute la dernière partie : c’est l’évacuation du Cap Hélles. Le matériel est préparé le jour, les hommes embarquent la nuit. Le mitraillage des positions turques est maintenu dans la journée : jets de grenades, bombardement des tranchées aux mortiers. Les Anglais continuent à s’adonner à leur sport favori sur les plages : le football. Il faut à tout prix donner le change que la guerre se poursuit, et ne rien laisser paraître quant aux préparatifs de retraite. Le 8 janvier, 16 000 hommes, 85 canons, 2700 mules et chevaux ont été évacués sans aucune perte. Dernier acte, les campements sont incendiés, ainsi que tout ce qui ne peut pas être emporté. C’est grâce à l’ingéniosité et à la discipline britannique qu’un pareil exploit a pu s’accomplir. Une armée colossale, étroitement rivée à une autre, s’évapora sans laisser de traces. En conclusion, et paradoxalement, la retraite sera la seule chose réussie par les Alliés aux Dardanelles. 
ANALYSE D’UNE CATASTROPHE ANNONCÉE
A cela, il Avec le recul qui convient, et concernant un tel fait historique, la stratégie adoptée par les Alliés peut paraître étrange. Le choix portait sur le Cap Hélles, la pointe de la presqu’île. Un lieu difficile à investir, aux falaises abruptes et qui présentait des accès quasi infranchissables. Alors que dans le nord, un débarquement par le golfe de Saros, à l’endroit où la bande de terre est la plus étroite, aurait permis de couper l’armée Ottomane en deux, de l’isoler et de la prendre à revers. L’accès à la mer de Marmara et la route de Constantinople auraient été grands ouverts, et les détroits auraient été contournés, à défaut d’être franchis en force. fallait rajouter la méconnaissance des lieux, avec l’utilisation de cartes inexactes, et des objectifs mal définis. Dès le début se développa un fort mépris de l’adversaire. Les forces turques et leur combativité étaient des éléments inconnus des stratèges de Londres, et furent sous-estimés. Conscients de leur supériorité, les assaillants ne jugèrent pas nécessaire d’engager les moyens suffisants pour mener cette expédition à la victoire.
fallait rajouter la méconnaissance des lieux, avec l’utilisation de cartes inexactes, et des objectifs mal définis. Dès le début se développa un fort mépris de l’adversaire. Les forces turques et leur combativité étaient des éléments inconnus des stratèges de Londres, et furent sous-estimés. Conscients de leur supériorité, les assaillants ne jugèrent pas nécessaire d’engager les moyens suffisants pour mener cette expédition à la victoire.
Ferdinand et Archibald sont alors regroupés dans Salonique, qui devient un immense rassemblement de soldats enclavés et menacés par les Allemands, les Austro-hongrois et les Bulgares. La situation du camp retranché devient préoccupante.
Les Grecs, indécis, sont partagés entre leur roi Constantin 1er, germanophile, et leur premier ministre Vénizélos, qui prône une alliance avec l’Entente. Les Franco-britanniques, bloqués, ne peuvent qu’attendre. Ferdy et Archy vont connaître alors la malnutrition et les maladies, comme la dysenterie, la malaria, le scorbut, et le paludisme. Pour combattre ces fléaux, qui viennent se rajouter à leurs malheurs, ils vont, comme des milliers de militaires, se mettre à cultiver la terre. Georges Clémenceau, avec son bagout si personnel, les appellera : « les jardiniers de Salonique »
Publié précédemment : « Du sang sur les bleuets » Éditions Volume.
Avec tous mes remerciements au service des archives de la ville d’Aix en Provence.
« A Journey to Gallipoli », nouvelle extraite de mon livre « Des Poppies et des larmes ».
Cette nouvelle est une fiction, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait qu’une pure coïncidence. Seuls les événements historiques sont authentiques.
Lire dans la même collection :
A journey to Gallipoli – L’embarquement
« Le Zeppelins : a Stairway to hell ! »
Sources :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Dardanelles1914-1918
Photos publiques Facebook
La Grande Guerre, Editions ALP/Marshall Cavendish, 1997/1998
14-18 Le magazine de la Grande Guerre, N°1 à 34 de 2001 à 2006
C’était la guerre des Tranchées, Tardi, Editions Casterman
Le Chemin des Dames, Pierre Miquel, Editions Perrin 1997
Mourir à Verdun, Pierre Miquel, Editions Tallandier 1995
Les mutineries de 1917, documentaire TV de Pierre Miquel
Paroles de Poilus, Editions Tallandier 1998
La première guerre mondiale, Suzanne Everett, 1983
Frères de tranchées, Marc Ferro, Editions Perrin 2005
Tous mes remerciements au services des archives de la ville d’Aix en Provence.































































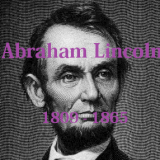


6 réponses
[…] A journey to Gallipoli – Terminus Gaba-Tepe […]
[…] A Jouney to Gallipoli – Terminus Gaba Tépé […]
[…] A Journey to Gallipoli – Terminus Gaba Tépé […]
[…] A journey to Gallipoli – Terminus Gaba Tépé […]
[…] A journey to Gallipoli – Terminus Gaba-Tépé […]
[…] https://jeanmarieborghino.fr/a-journey-to-gallipoli-terminus-gaba-tepe/ […]