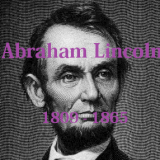L’église Notre-Dame de Beauvoir, à Grambois
LES TÉMOINS DU PASSÉ

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUVOIR, DE GRAMBOIS

L’église Notre-Dame de Beauvoir

Blason de la ville de Grambois
TYPE : église paroissiale.
STYLE : roman et gothique.
NOM LOCAL : église Notre-Dame de Beauvoir.
VOCABLE : Notre-Dame.
CULTE : catholique romain.
DÉPENDANCE : Notre-Dame de Beauvoir était à l’origine un prieuré bénédictin dépendant de l’abbaye de Saint-André, de Villeneuve-lez-Avignon.
ÉPOQUE : Moyen Âge.
PÉRIODE DE CONSTRUCTION : XIIème siècle (l’église priorale est mentionnée pour la première fois en 1096).
ÉTAT DE CONSERVATION : l’église fut modifiée, remaniée et agrandie au cours des siècles. En outre, en 1708, elle fut gravement endommagée par un tremblement de terre, puis reconstruite.
Un programme de réhabilitation du clocher-mur à trois baies fut lancé en 2006, et vit sa réalisation en 2008.
PROTECTION : inscription sur la liste des Monuments Historiques le 29 janvier 2001.
PROPRIÉTAIRE : la commune.
COMMUNE : Grambois.

DÉPARTEMENT : Vaucluse.

RÉGION : Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LOCALISATION

Grambois
L’église Notre-Dame de Beauvoir est une église catholique romaine qui se situe dans la ville de Grambois, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
GRAMBOIS
LES VESTIGES DES REMPARTS
Grambois est une commune située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette charmante ville provençale (Grambois est classé « village fleuri ») se trouve dans la partie sud-est du département du Vaucluse, sur le versant sud du « Grand Luberon », au cœur de la vallée d’Aigues. Nichée sur un coteau escarpé, à l’est du Parc naturel régional du Luberon, elle surplombe la vallée de l’Èze.
Grambois est classé « village fleuri ». Ses ruelles en « calade » et sa fontaine centrale, provençale, ont attiré le cinéaste Yves Robert qui tourna, en 1990, plusieurs scènes de son film, « La Gloire de mon père » (tiré du célèbre roman éponyme de Marcel Pagnol). C’est ici qu’il a filmé « la partie de boules », la fameuse « chasse aux bartavelles », ainsi que la suite, « Le Temps des secrets », de Christophe Barratier. Le village de Grambois est aussi cité dans les œuvres de Jean Giono.

Une « Calade » (calada) est le terme français de la langue d’oc pour désigner la pierre qui sert à paver les rues, le pavé, ou la rue pavée.
En 2022, la population de Grambois s’élevait à 1204 habitants, les Gramboisiennes et les Gramboisiens.

ESCAPADES VAUCLUSIENNES
L’église Notre-Dame de Beauvoir de Grambois se trouve à 23 km de l’église Saint-Étienne de Cadenet 24 km du château de Lourmarin, à 42,3 km de l’abbaye Saint-Hilaire, à 48 km de Saint-Saturnin-lès-Apt, à 56, 5 km de l’Abbaye Notre-Dame de Sénanque, à 67,9 km de l’église Notre-Dame-du-Lac du Thor, à 70,4 km du baptistère de Venasque, à 70,6 km du château de Thouzon, à 70,8 km des Tours sarrasines de Venasque, à 76,9 km de Pernes-les-Fontaines, cité médiévale, à 77,2 km de la Tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines, à 106 km de l’arc de Triomphe d’Orange, et du Théâtre antique d’Orange, à 112 km du château du Barroux, à 130 km du théâtre de Vaison la Romaine, du site antique de Vaison la Romaine, et de la cathédrale Notre Dame de Nazareth de Vaison la Romaine, et à 159 km du château des Adhémar. (Sources Google Maps).

HISTORIQUE

La fontaine et la mairie en arrière plan
LE MOYEN ÂGE
Dressée sur la place principale du village (place de la Mairie), l’église est adossée au nord-ouest au presbytère et à l’ancien château. De l’extérieur, la promiscuité de ces différents bâtiments désavantage certainement la vue générale de l’édifice. Mais le tout s’affiche comme un ensemble typiquement provençal : une petite église romane à nef unique, constituée de trois travées et d’une abside.
L’église priorale de Grambois (aujourd’hui paroissiale Notre-Dame-de-Beauvoir) fut mentionnée pour la première fois en 1096, dans un privilège accordé par le pape Urbain II à l’abbaye Saint-André-lès-Avignon. Grambois y était qualifié d’oppidum.
En 1143, l’église fut citée de nouveau dans une confirmation par le pape Innocent II.
En 1165, elle fut mentionnée dans un pacte passé entre Pierre IV (l’archevêque d’Aix-en-Provence) et Pons (l’abbé de Saint-André).
Enfin, l’église fut mentionnée en 1227, 1274 et 1351.
Conséquence de l’expansion démographique des XIIIème et XIVème siècles, l’église s’avéra trop petite pour pouvoir accueillir tous les paroissiens (malgré le rajout de tribunes) ; il fallut donc l’agrandir.
Au milieu du XIVème siècle, on rallongea alors la nef d’une quatrième travée voûtée en berceau brisé, et d’une abside rectangulaire recouverte d’une voûte sur croisée d’ogive (le chœur actuel).
En 1348, grâce au legs d’un noble, on conçut la chapelle Saint-Jean-Baptiste au sud de la quatrième travée.
La région devint ensuite prospère avec l’établissement des papes en Avignon.
En 1360, la reine Jeanne concéda la seigneurie de Grambois à Guy Albert (un neveu du pape Innocent VI).
Lire : La chartreuse Notre-Dame-du-Val-de-Bénédiction
En 1423 et 1486, deux visites pastorales déclarèrent l’église en bon état.
ÉPOQUE MODERNE, « TEMPS MODERNES » (entre 1492 et 1789)
Au XVIème siècle, l’église fut déclarée de nouveau trop petite. Le 21 janvier 1545, la commune de Grambois passa un marché avec Jacques Jehan (maçon de La Tour-d’Aigues), pour agrandir l’édifice religieux.
Un arrangement fut conclu le 24 janvier 1560 ; il fut convenu de détruire les trois chapelles latérales des trois premières travées de la nef. On les remplaça par un bas-côté (ou collatéral) voûté d’arrêtes au sud, entre le mur de la façade de l’église et la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Ce remaniement conduisait à la quatrième chapelle.
Jacques Jehan réalisa une charpente au-dessus des voûtes de la nef, et dut surélever le clocher.
LES GUERRES DE RELIGION
A la fin des années 1580, les Guerres de Religion faisaient rage.
L’église, qui prenait appui contre le rempart, fut incluse dans le programme de restauration des fortifications du village.
En guise de guérite et de poste de défense, Jean de Gautier (le seigneur de Grambois) fit construire une salle voûtée au-dessus du chœur (1589-1590).
En 1589, Jean de Gautier (le seigneur de Grambois) organisa un programme de fortification du village. Une tour avec une chambre voûtée fut bâtie au-dessus du chœur. Les parties hautes de l’église furent transformées pour y incorporer des défenses.
En 1590 eut lieu le siège du village par les armées savoyardes (on en distingue encore les traces sur le clocher oriental, grêlé des impacts des tirs de mousquets).
La maison claustrale située contre l’église fut transformée en château. Les travaux furent attribués à Nicolas Bérard (maçon de La Tour d’Aigues). Il reconstruisit aussi la grande porte de l’église « ornée de deux pilastres ».
La sacristie fut construite en 1657 contre le flanc sud du chœur.
Au cours du XVIIème siècle, trois chapelles latérales furent rajoutées sur le côté nord de la nef.
L’église fut sérieusement endommagée par le tremblement de terre de 1708, ce qui provoqua l’effondrement de la voûte en berceau (elle sera rebâtie ainsi que les parties hautes).
La façade fut aussi reconstruite, et on lui accola un petit clocher destiné à recueillir l’horloge.
Au XIXème siècle, un campanile en fer forgé y fut ajouté.
En 1855, la partie de la sacristie dont la voûte s’était écroulée fut reconstruite.

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE BEAUVOIS
L’EXTÉRIEUR
LA FAÇADE OCCIDENTALE
LA PLACE DE L’ÉGLISE
LE CAMPANILE DE 1870
LE CLOCHER-MUR DE 1708
LES CONTREFORTS DE LA FAÇADE MÉRIDIONALE
L’INTÉRIEUR
LA NEF
L’église est composée d’une nef de 4 travées : 3 voûtées d’arêtes, et la 4ème en berceau brisé.
LE CHŒUR
Le chœur est carré et voûté en croisées d’ogives.
LE COLLATÉRAL
Le collatéral unique se compose de 3 travées voûtées d’arêtes et d’une chapelle latérale voûtée d’ogives au sud.
LES CHAPELLES LATÉRALES DES XIVème ET XVIème SIÈCLES
Les chapelles latérales sont au nombre de trois ; elles sont voûtées, l’une en berceau plein-cintre, et les autres en croisées d’ogives.
La première chapelle date de 1661 ; c’est l’ancienne chapelle Sainte-Anne ; elle est aujourd’hui dédiée à Saint Jean-Baptiste. Elle abrite les fonts baptismaux en calcaire coquillier, ornés de godrons (du XVIIIème siècle). On distingue surtout le très remarquable polyptique de Saint-Jean-Baptiste (daté de 1519).
LA CHAPELLE DÉDIÉE A MARIE
La deuxième chapelle, dédiée à Marie, est postérieure à la précédente. Elle abrite une statue de la Vierge à l’Enfant (bois polychrome et dorures) datant du XVIIème siècle.
LA CHAPELLE SAINT PANCRACE
La chapelle Saint-Pancrace, la plus profonde et la plus remarquable, est dédiée au Saint tutélaire du village.
Elle y abrite un autel en bois polychrome, avec un buste reliquaire (du début du XVIIIème siècle) et un retable de Saint-Pancrace du XVIIIème siècle.
Sur le mur occidental, on découvre un tableau du XVIIIème siècle représentant l’Education de la Vierge, attribué à Mignard.
Sur le mur oriental se trouve un tableau peint qui représente Sainte Thérèse d’Avila (du XIXème siècle).
LES COLONNETTES ET LES CHAPITEAUX
LES VOÛTES
Voûtes en berceau plein-cintre, et en croisées d’ogives.
En architecture, l’arc plein cintre est un arc parfaitement semi-circulaire sans brisure. Il se distingue des arcs surbaissés et des croisées d’ogives. Constitués d’un appareil régulier, tous les moellons sont de même taille et de même forme. Voûte en berceau : voûte semi-cylindrique, engendrée par un arc en plein cintre.
LES TABLEAUX
LES VITRAUX

Sources :
Mes photos
Photos publiques Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grambois#%C3%89glise_paroissiale_Notre-Dame_de_Beauvoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grambois#Histoire
https://www.grambois.fr/l-eglise