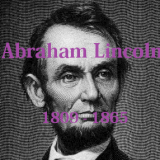Minerve, cité cathare
LES TÉMOINS DU PASSÉ

MINERVE, CITÉ CATHARE

Minerve

Blason de la cité cathare de Minerve
TYPE : ville cathare médiévale.
ORIGINE : son nom est attesté dès 843 sous la forme latinisée « pagus Minerbensis ».
ÉPOQUE : Moyen Âge.
NOM LOCAL : Minerve.
Encerclé de gorges profondes érodées par la confluence du Brian et de la Cesse, dressé à l’extrémité d’un plateau calcaire, Minerve est un village chargé d’Histoire au cœur de la garrigue languedocienne.
Cet ancien bastion cathare fut ravagé en 1210 par Simon de Monfort (chef de la Croisade des Albigeois). Le village conserve de cette période une stèle en mémoire d’un bûcher cathare. Minerve est également connu et reconnu pour son vin, produit depuis des siècles par ses vignerons.
ENTREPRISES ET COMMERCES
Tourisme : Depuis la fin du XXème siècle, l’intérêt massif pour l’histoire des Cathares et le tourisme vert ont restructuré Minerve et son Histoire. Des centaines de milliers de touristes visitent la ville à la belle-saison, occasionnant de nombreuses nuisances ; la pression touristique est importante sur un environnement très fragile.
Viticulture : production de vins en AOC Minervois.
PROTECTION : Minerve a été inscrite sur la liste des « Plus beaux villages de France ».

POPULATION : en 2022, la population de Minerve s’élevait à 96 habitants, les Minervoises et les Minervois.
COMMUNE : Minerve (qui a donné son nom au Minervois) est la capitale historique du pays minervois.

La commune est située dans le « Minervois », une région agricole occupant une petite partie du sud-ouest du département de l’Hérault.
Minerve tire son nom de l’occitan « Menèrba », du celte « men » (pierre, roche) et de dérivés de « herbech » (asile, refuge).
DÉPARTEMENT : Hérault.

RÉGION : Occitanie (anciennement région de Languedoc-Roussillon).

BALADES CATHARES
Le château de Quéribus, le château de Villerouge Termènes, l’abbaye de Caunes Minervois, l’abbaye de Saint-Hilaire, l’abbaye d’Alet-les-Bains, le château de Puivert, le château de Termes, le château d’Arques, le château de Saissac, l’abbaye de Saint Papoul, l’abbaye de Villelongue, l’abbaye de Lagrasse, l’abbaye de Saint-Polycarpe, le château de Peyrepertuse.
DANS LE MINERVOIS

Vue aérienne de Minerve
Minerve (Hérault) se trouve à 13,9 km de la Chapelle Saint-Michel à Homps, à 20,8 km de l’église Saint-Martin d’Escales, à 22,7 km de l’église Notre-Dame de Rieux-Minervois, à 25,2 km de l’église Notre-Dame de Puichéric, à 27, 7 km de la Chapelle Notre-Dame du Cros de Caunes Minervois, et à 28,7 km de l’église Saint-Étienne de Blomac.

HISTOIRE

Vue aérienne de Minerve
EN BREF
Le Minervois fut habité dès la Préhistoire, comme en témoignent les vestiges de la grotte d’Aldène, le dolmen des Fades, ou encore le Musée d’Archéologie et de Paléontologie de Minerve.
Les premières mentions écrites de Minerve datent de 873. Par la suite, le castrum passa progressivement de l’autorité des vicomtes de Béziers à celle des comtes de Carcassonne.
Le castellum militaire est un fortin, généralement intégré dans le système de fortification du limes (système de fortifications établi le long d’une frontière). Au Moyen Âge, le castellum c’est aussi le château central du castrum (village plus ou moins fortifié sur une hauteur, notamment dans la région du Languedoc).
C’est en 1210 que Minerve vécut la période la plus tragique de son histoire. La « Croisade contre les Albigeois » fut lancée par le pape Innocent III, afin de faire revenir les seigneurs occitans au respect de la foi de Rome, et pour bannir l’hérésie cathare.
Après un siège de cinq semaines au cœur de l’été, les « Parfaits » (défenseurs cathares de Minerve), privés d’eau et bombardés de toutes parts, capitulèrent. Ils durent choisir entre abjurer leur foi ou être brûlés vifs. Seuls trois Minervois abjureront. Les autres habitants seront condamnés au bûcher.
Lors des Guerres de Religion, la ville fut à nouveau dévastée. En 1636, son château fut démantelé, et Minerve isolée.
En 1912, l’ultime modification d’importance concerna l’achèvement des travaux du viaduc. Un accès direct au village fut désormais ouvert, désenclavant la vieille cité de Minerve.

L’ÂGE DU BRONZE
La cité de Minerve fut occupée depuis l’époque du bronze final, entre 850 et 725 avant J.C. (source Persée). On ne sait pas s’il s’agissait d’un habitat permanent ou temporaire, ni si cette occupation possédait un caractère fortifié (ex : oppidum). Après un oubli de plusieurs siècles, le site paraît avoir été réoccupé aux 11ème et Ier siècles avant J.-C. Mais ce fut surtout au Vème siècle et au VIème siècle que cet habitat paraît avoir été établi pour durer.
LE HAUT MOYEN ÂGE
Le « pagus minerbensis » apparaît dans les textes à l’époque carolingienne. Dans une charte de 836, on distingue le « territorium Narbonense » et le « suburbium Minerbense ». Il y a donc déjà une viguerie carolingienne dès cette époque.
Il est fort probable que ce soit pour sa configuration naturelle (site de défense inexpugnable) que le lieu fut choisi. Il est vraisemblable que les invasions sarrasines des « Ommeyades », après 719, aient imposé ce choix pour mettre à l’abri les populations.
La première annotation écrite du castrum de Minerve, « castrum menerba », apparut à l’occasion d’une assemblée de justice tenue en 873 « devant le lieu fortifié de Minerve et à l’autel de Saint-Nazaire, dont l’église était située dans les environs du village sous la présidence de Bérald, vicomte de Minerve, et en présence de Salomon, délégué du roi. »
Le château de Minerve faisait partie des biens des vicomtes de Béziers ; en atteste le testament daté de 1002 de Roger Ier, comte de Carcassonne. Le document indique que celui-ci a reçu, en 969, de Rainard (vicomte de Béziers), une part du « castellum de Minerve ».
Roger Ier céda sa part à son fils Raimond, mort prématurément.
On peut supposer qu’une autre partie dépendait des vicomtes de Béziers. En 990, le vicomte Guilhem de Béziers, fils de Rainard, ne cita pas Minerve dans son testament.
On vit apparaître, dans les donations de Minerve, Ermangaud (archevêque de Narbonne), fils de Matfred (vicomte de Narbonne).
Cette donation d’Ermangaud à son neveu Guilhem (probablement le petit-fils de Roger Ier) fut peut-être due au fait que le Minervois faisait partie de Narbonne.
Après cette donation, Minerve va progressivement dépendre des comtes de Carcassonne.

LE BAS MOYEN ÂGE
LA CROISADE DES ALBIGEOIS

Simon de Montfort
En 1209, des milliers de chevaliers du nord de la France et de toute l’Europe franchissent le Rhône et déferlent dans le Languedoc. Ils répondent à l’appel du pape Innocent III pour soumettre les seigneurs occitans, les ramener au respect de la foi de Rome, et éradiquer définitivement l’hérésie cathare.
L’armée croisée s’attaque d’abord au puissant vicomte Raimond-Roger Trencavel, qui domine une grande partie du Comté de Toulouse : les vicomtés d’Albi, de Béziers et de Carcassonne.
UN PEU D’HISTOIRE…
Blason du Languedoc Vers le milieu du 12ème siècle, alors que l’Europe est dominée par une profonde et ardente foi catholique, le Midi toulousain est gagné par une hérésie toute aussi enflammée, le Catharisme. Cette nouvelle religion, qui apparaît vers le 12ème siècle dans les Balkans bulgares, s’appuie essentiellement sur une dualité. Ses disciples, « les Parfaits », croient en deux principes divins opposés : d’une part un monde spirituel avec un Dieu bon, celui de l’Évangile, et de l’autre un monde matériel et corrompu avec un prince du mal et des ténèbres, Dieu de l’Ancien Testament. Les valeurs morales et l’austérité de ses adeptes contrastent avec l’opulence et le relâchement des représentants de l’Église catholique. Les cathares rejettent les sacrements, les indulgences, le purgatoire et le culte des saints. Ils ne glorifient point le sacrifice de la croix, et ne reconnaissent pas le pape comme le successeur légal des apôtres. Refusant le concept de propriété et condamnant le serment, ils sont considérés comme subversifs par la société féodale et par la royauté. Les fondations du christianisme vont chanceler, au point de décider le pape Innocent III à déclarer les « Bons Hommes » et les « Bonnes Dames », hérétiques. En France, lorsque les croyances cathares apparaissent, la chrétienté est partagée au sein de l’Église et une grande divergence d’idées demeure entre les Français du Nord et les gens du Midi. Alors que ceux du Nord admettent la foi catholique romaine, dans les régions du Sud l’on a adopté l’« arianisme » depuis les premières heures du christianisme. Cette disparité va opposer le Languedoc à l’autorité de Rome, et faire de lui un foyer où les hérésies et les schismes vont se développer sans contrainte. L’ÉTINCELLE C’est vers le début du 13ème siècle, en 1204, que le pape Innocent III demande au roi Philippe Auguste (Philippe II) de mener une croisade contre les hérétiques cathares du Languedoc. Pour mener à bien la lutte contre cette nouvelle religion qui fait vaciller les dogmes de l’église catholique, le pape nomme dans cette région les légats apostoliques Pierre de Castelnau et Arnaud Amaury. Le sud de la France va alors s’embraser dans une guerre fratricide, qui opposera ses habitants et ses seigneurs aux forces de l’Église Catholique qui ont pris la Croix. Plus connue sous le nom de Croisade des Albigeois, cette guerre dévastera le midi et durera plus de 30 ans. La contrée sera ravagée, pillée et ruinée. Les années de destructions et de combats vont plonger le pays dans la famine et l’appauvrissement. Avec autant de morts et de désolation, peut-on parler de génocide ? Même de nos jours, il est difficile de faire ressortir un véritable coupable de cette triste page de notre histoire. L’expédition porte officiellement le nom d’« Affaire de la Paix et de la Foi » (en latin, « negotium pacis et fidei »). Innocent III promet les mêmes indulgences que pour un pèlerinage à Jérusalem. Philippe II refuse la proposition ; il est trop occupé dans son combat avec les Plantagenêt et ne prend pas part à la croisade contre l’hérésie cathare. Il préfère se tenir en retrait, ne voulant pas écorner son image en guerroyant contre des gens qui sont ses sujets. Il n’est pas d’accord avec le pape qui s’apprête à s’investir dans une affaire intérieure au pays, et il le lui fait savoir. Mais il accorde néanmoins sa bénédiction à ses vassaux et ne s’oppose pas à ce que l’abbé Guy des Vaux-de-Cernay recrute parmi les barons du nord. Le légat pontifical Pierre de Castelnau essaie alors de se tourner vers Raymond VI de Toulouse, afin que celui-ci prenne la tête d’une force armée destinée à soumettre l’hérésie cathare. Mais le Comte de Toulouse, descendant du notoire Raymond IV de Saint-Gilles, chef de la Première Croisade en terre sainte, réfute l’offre du pape, arguant qu’il ne veut pas combattre ses propres sujets. Jugé trop complaisant envers les ennemis de l’Église, il sera excommunié. Fait inédit dans l’Histoire, pour la première fois une croisade est dirigée contre des disciples du Christ. Cet événement ne semble pas troubler les contemporains de cette époque ; il est vrai que l’hérésie cathare ne peut être tolérée. Le choix d’Innocent III va se porter sur Simon de Montfort, un petit seigneur d’Île-de-France. Ce dernier va mettre le Languedoc à feu et à sang. Armoiries de Simon de Montfort L’ARIANISME C’est à Arius (256-336), théologien alexandrin, que l’on attribue au début du 4ème siècle le courant de pensée théologien, l’« arianisme ». Sa pensée assure que si Dieu est divin, son fils Jésus, lui, est avant tout un humain mais possède cependant une part de divinité. C’est en 325 que le Concile de Nicée, rassemblé par l’empereur Constantin, rejeta l’« arianisme », jugé hérétique.
Le catharisme, une menace pour l’Église et pour le Roi

Lire :
Le « castrum » de Minerve est alors un village fortifié lié à un château. Le castrum et le « pagus minerbensis » (pays minervois) dépendent du seigneur de Minerve, le vicomte Guilhem. Cerné par les vallées encaissées de la Cesse et du Brian, perché sur son rocher, le castrum de Minerve apparait comme inexpugnable. Au milieu du mois de juin 1210, les Croisés de Montfort, avec l’aide des Narbonnais, assiègent Minerve. Les barons du nord installèrent les machines de siège : quatre trébuchets (mangonneaux et catapultes), construits sur place, encerclent et pilonnent les remparts de la cité fortifiée.
La pierrière : cet engin diabolique, qui propulse un projectile meurtrier et qui s’inspire du principe du balancier, est dans sa version primitive d’une redoutable efficacité. Il est doté d’un bras mobile fixé sur une poutre verticale. Une des extrémités est chargée d’un bloc de pierre ou d’un boulet, et sur l’autre, plus courte, l’on a fixé un système de câbles. Les servants actionnent l’engin en tirant un coup sec sur les cordes pour propulser le projectile. Lire : le château de Caerphilly, au Pays de Galles Avec le temps, la machine va subir des transformations et se perfectionner grâce à l’intervention de véritables ingénieurs. Elle change de nom et devient mangonneau. Un détail qui fait toute la différence, car la force motrice fournie par l’homme est remplacée par un contrepoids qui se substitue à la traction humaine. Enfin elle prend le nom de trébuchet lorsque la présence de l’homme n’est plus demandée. Des projectiles de cent kilos peuvent alors être envoyés à plus de deux cents mètres, avec une précision millimétrée. L’engin se révèle ainsi très efficace contre les murailles, et devient la hantise des villes assiégées. Il ne sera supplanté qu’avec l’avènement de l’artillerie.

Bâti en surplomb d’un rempart, il permettait de jeter toute sortes de projectiles, à la verticale, sur les assaillants.
C’est le début de l’été ; les causses du Minervois sont arides, et les deux rivières du Brian et de la Cesse sont, comme chaque année en cette saison, complètement à sec.
Le point faible de Minerve est l’accès à l’eau. Son unique puits (le puits Saint-Rustique, encore visible aujourd’hui) est situé au pied de la cité, et on y accède par une rampe fortifiée.
Grâce à la « Malvoisine » (Mala Vezina), Simon de Montfort parvient à détruire rapidement l’accès au puits. Un trébuchet (la Malvoisine) situé au-dessus du puits projette non seulement des boulets de pierre, mais aussi, sans doute, des cadavres d’animaux en décomposition, qui, au bout de plusieurs jours, provoquent des maladies en pourrissant.
LA MALVOISINE
CE QUE L’ON SAIT DU TRÉBUCHET DE MINERVE…
« Au siège du château de Minerve, on éleva du côté des Gascons une machine de celles qu’on nomme mangonneaux, dans laquelle ils travaillaient nuit et jour avec beaucoup d’ardeur. Pareillement, au midi et au nord, on dressa deux machines, à savoir une de chaque côté. Enfin, du côté du comte, c’est-à-dire à l’orient, était une excellente et immense pierrière, qui chaque jour coûtait vingt-et-une livres pour le salaire des ouvriers qui y étaient employés ».
Vers le 20 juillet, Minerve, qui résiste depuis cinq semaines, à bout de vivres et affamée, se décide de capituler. Guilhem de Minerve sort négocier, pour sauver sa population et sa cité. Finalement, il est contraint à la reddition sans condition. Néanmoins, Simon de Montfort fait preuve de mansuétude. Il promet de laisser la vie sauve à la population, ainsi qu’aux « parfaits cathares » (les « bonshommes », ou « Bons-Chrétiens ») qui se sont réfugiés dans la cité, s’ils abjurent leur foi. Tous sauf trois femmes, sauvées de justesse par Mathilde de Garlande, refusent de se renier. Environ 140 à 180 « parfaits » (selon les sources) périssent ce jour-là sur le bûcher.
Les autres cathares qui n’étaient pas des « parfaits », terrorisés, abjurent et ont la vie sauve. Guilhem reçoit alors de Simon de Montfort des terres du côté de Béziers. Montfort laisse sur place une petite garnison, et repart poursuivre son œuvre destructrice dans les Corbières.
Après cinq semaines de siège et de bombardements, on peut facilement imaginer l’état dans lequel se trouvent le château et les remparts de Minerve.
Il ne reste presque rien du Minerve de 1210, sinon quelques éléments de maçonnerie des soubassements des remparts et du château. Les structures apparentes actuelles datent d’une période de reconstruction des forteresses occitanes de la fin du XIIIème siècle. En 1271, Philippe le Hardi rattache définitivement le Languedoc à la couronne de France, et Minerve devient alors une châtellenie, administrée par un châtelain.
En 1355, le Prince Noir (Edouard de Woodstock), le fils du roi d’Angleterre, débarque à Bordeaux. À la tête d’une puissante troupe, il répand la terreur jusque dans le Minervois.
Lire : la Guerre de Cent Ans
En 1363, des bandes armées venant d’Espagne dévastent la région et s’emparent du château de Peyriac. En 1364, elles prendront celui de Minerve, avant d’être délogées assez rapidement de ces deux places-fortes par des milices venues de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire.

LES GUERRES DE RELIGION

Minerve
L’éradication progressive du Languedoc et des pays occitans (terres du comté de Toulouse et des Trencavel) marque la fin des châteaux fortifiés.
Sous Louis XIV, la frontière du royaume de France s’éloigne de plus en plus au sud, jusqu’aux Pyrénées. La féodalité disparaît pour laisser place à la « paix capétienne ». Les anciennes « citadelles du vertige » n’ont plus lieu d’être. Les populations désertent les cités défensives pour aller s’installer au plus près des routes de commerce, au cœur des terres riches de la plaine, où l’eau abonde. Minerve n’est plus qu’un petit village isolé, difficile d’accès, et situé au cœur de terres arides et sans eau.
De 1562 à 1598, les Guerres de Religion se succèdent et le Minervois est ravagé. Ce sont alors les barons de Rieux, proches des Montmorency, qui deviennent les gouverneurs de la place-forte royale de Minerve.
Un certain Bacou, capitaine huguenot, natif de Pierrerue, près de Saint-Chinian, combat dans le camp protestant, et surtout pour son propre compte, contre le baron de Rieux. En février 1582, il s’empare par surprise du château de Minerve, et à partir de cette position stratégique lance des expéditions dans la région. Il en sera délogé sept mois plus tard par le gouverneur de Narbonne. Au mois de juillet, sur l’ordre du duc de Montmorency, Minerve sera assiégé, et Bacou sera contraint de se retirer. Gracié, il changera de camp et rejoindra celui de Montmorency.
En 1588, à la suite de ces événements, des travaux sont entrepris au château de Minerve : construction du pont-levis, et réparation de la porte d’entrée du pont, entre le château et la cité.
« Une plainte du syndic du diocèse de Saint-Pons œuvra au même moment pour la démolition du château et y parviendra quelques années plus tard. ».
En 1636, le château est démantelé.

MINERVE, CITE CATHARE

Vue panoramique de Minerve
LA PLACE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
LA CANDELA
LA COLOMBE DE LUMIÈRE…
Extrait du communiqué de presse, émis lors de l’inauguration de la stèle.
« Sur l’emplacement présumé du bûcher des cathares de Minerve se trouve actuellement un monument. L’inscription occitane « als catars » signifie « aux cathares ». L’auteur a voulu un monument aussi sobre que possible.
LA PORTE DES TEMPLIERS

Jadis, cette porte était celle de la Maison des Templiers. Une croix de Malte, aujourd’hui effacée, décorait auparavant la clé de voûte.
LES RUELLES DU VILLAGE
LA RUE DE LA CALADE
« Calade » (calada) est le terme français de la langue d’oc pour désigner la pierre qui sert à paver les rues, le pavé, ou la rue pavée.
VUES GÉNÉRALES
LES FALAISES
LES REMPARTS
A ne pas confondre avec l’« opus spicatum », qui est un « appareil » du même style architectural mais qui a la forme d’un épi.
LES MEURTRIÈRES ET LES ARCHÈRES

Sources :
Mes photos
Photos publiques Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minerve_(H%C3%A9rault)#
https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/minerve/
https://www.minerve-occitanie.fr/histoire/
https://www.herault-tourisme.com/fr/decouvrir/nos-incontournables/la-cite-cathare-de-minerve/
https://amandebasilic.com/minerve-cite-medievale/
https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_2012_num_124_279_7415