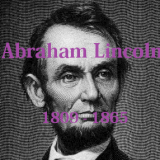L’église de Notre-Dame de Rieux-Minervois
LES TÉMOINS DU PASSÉ

L’ÉGLISE DE L’ASSOMPTION DE NOTRE-DAME
DE RIEUX-MINERVOIS

Notre-Dame de Rieux-Minervois

Blason de la ville de Rieux-Minervois
TYPE : église.
STYLE : art roman languedocien.
NOM LOCAL : église de l’Assomption.
VOCABLE : Assomption de Marie.
CULTE : catholique.
ÉPOQUE : Moyen Âge.
PÉRIODE DE CONSTRUCTION : citée pour la 1ère fois en 1096/1097, au XIème siècle. La date précise de l’édification de l’église Sainte Marie n’est pas connue. Ce que l’on sait, c’est que Monseigneur Dalmace, Archevêque de Narbonne, décéda à Rieux en 1096 en venant superviser le début des travaux de l’église.
ÉTAT DE CONSERVATION : l’église fut modifiée, remaniée et agrandie au cours des siècles.
PROTECTION : classement sur la liste des Monuments Historiques en 1840.
PROPRIÉTAIRE : la commune.
COMMUNE : Rieux-Minervois.

DÉPARTEMENT : Aude.

RÉGION : Occitanie (anciennement région de : Languedoc-Roussillon).

LOCALISATION

Notre-Dame de Rieux-Minervois
L’église de l’Assomption-de-Notre-Dame (ou église Sainte-Marie) est une église romane située à Rieux-Minervois, dans le département de l’Aude, en région Occitanie.
RIEUX-MINERVOIS

Rieux-Minervois
Rieux-Minervois est une commune française située dans le nord du département de l’Aude. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Minervois.
Le Minervois est une région naturelle de France située dans la région Occitanie. Le pays, constitué de basses collines, s’étend du Cabardès, à l’ouest, au Biterrois à l’est, et de la Montagne Noire, au nord, jusqu’au fleuve Aude au sud.
En 2022 sa population s’élevait à 1926 habitants, les Mérinvilloises et les Mérinvillois.
BALADES CATHARES
Le château de Quéribus, le château de Villerouge Termènes, l’abbaye de Caunes Minervois, l’abbaye de Saint-Hilaire, l’abbaye d’Alet-les-Bains, le château de Puivert, le château de Termes, le château d’Arques, le château de Saissac, l’abbaye de Saint Papoul, l’abbaye de Villelongue, l’abbaye de Lagrasse, l’abbaye de Saint-Polycarpe, le château de Peyrepertuse.
DANS LE MINERVOIS

Minerve
L’église Notre-Dame de Rieux-Minervois se trouve à 9,1 km de l’église Notre-Dame de Puichéric, à 10, 3 km de la Chapelle Notre-Dame du Cros de Caunes Minervois, à 11,6 km de l’église Saint-Étienne de Blomac, à 12,1 km de l’église Saint-Martin d’Escales, à 12,6 km de la Chapelle Saint-Michel à Homps, et à 21,8 km de Minerve (Hérault).

Le marbre de Caunes-Minervois (appelé aussi marbre de Languedoc) est un marbre de couleur rose pâle à rouge sang, veiné de blanc. Il est exploité depuis la Rome antique, et encore de nos jours. Le marbre de Caunes est extrait des carrières de Caunes-Minervois, un petit village de l’Aude, dans la région Occitanie. Exploité déjà à l’époque romaine, il fut beaucoup utilisé dans les constructions médiévales, églises et maisons bourgeoises de la région, ainsi qu’en Espagne. On l’utilisait pour construire des chapiteaux, des colonnes, des retables, ainsi que de nombreux embellissements et ornementations des sanctuaires religieux. Laissé à l’abandon, c’est au début du XVIIème siècle qu’un sculpteur génois reprit son exploitation, et le commercialisa à nouveau avec succès. LA CARRIÈRE DU ROY A partir de la fin du XVème siècle, les marbres rouges du Languedoc vont jouir d’une grande célébrité. Exportés à l’origine vers l’Italie, ils vont être choisis par le roi Louis XIV pour embellir le château de Versailles. LE MAGASIN DES MARBRES DE CHAILLOT Le marbre commandé en grande quantité était stocké à Paris au magasin des marbres de Chaillot. Les blocs y attendaient la réalisation du projet pour lequel ils avaient été spécifiquement extraits ; mais il arrivait que certains soient modifiés ou abandonnés. En 1689, les carriers de Caunes-Minervois avaient ainsi livré 41 tambours (pièces de colonnes monumentales), et 27 colonnes complètes destinées à des projets versaillais de chapelles et de bassins, vite oubliés. Certaines de ces pièces furent redécouvertes et utilisées plus d’un siècle plus tard, en 1806, lorsque Napoléon 1er décida de la construction de l’Arc de Triomphe du Carrousel, aux Tuileries, qui reçut ainsi des colonnes en incarnat, non prévues à l’origine ! DU VATICAN A VERSAILLES Au tout début du XXème siècle, les carrières de Caunes-Minervois, laissées en désuétude, devinrent la propriété de l’Abbaye de De Caunes Minervois. L’abbé Jean d’Alibert, nommé au siège abbatial par Henri IV, était issu d’une riche famille de Caunes. Associé aux maîtres marbriers génois, il va tout faire pour relancer l’exploitation des marbres et assurer un commerce régulier vers la péninsule italienne, via les ports d’Agde et de Narbonne. L’Incarnat, le Griotte et le Turquin, reconnus pour leur qualité, furent ainsi employés dans de nombreuses églises italiennes (notamment au Vatican, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, mais aussi à l’Annunziata de Gênes, et à la chartreuse de Pavie), où ils furent associés au marbre blanc de Carrare. La réputation des marbres du Minervois atteignit alors la Cour : Louis XIV en fit des commandes importantes, destinées à l’embellissement du Louvres et d’autres bâtiments royaux. L’achèvement du Canal du Midi, en 1681, facilitera l’acheminement du marbre vers Paris : ce dernier façonnera les cheminées, les pavements et les revêtements de Versailles, les 277 pilastres et les 14 colonnes monolithiques des façades du Grand Trianon. Plus tard, il agrémentera les sols et les plafonds du Petit Trianon de Marie Antoinette, sera utilisé lors de la construction de l’Opéra Garnier de Paris, dans les palais de Saint-Pétersbourg et de Washington.
Lire :
L’Abbaye de De Caunes Minervois.

HISTORIQUE

Façade d’entrée
Une cité datant de l’époque gallo-romaine semble avoir vu le jour sur les berges de la rivière l’Argent-Double.
A sa mort à Rieux, en 1096, Monseigneur Dalmace, archevêque de Narbonne, céda l’église au chapitre de Narbonne.
En 1129, l’archevêque Arnaud de Lévézou confirma le don aux chanoines de la cathédrale. Les actes de 1165, 1181, 1185, 1252 attestent qu’elle fut érigée en prieuré. Elle fut réunie à la mense (revenu ecclésiastique) capitulaire au milieu du XVème siècle. La réunion fut confirmée en 1448 par Nicolas V.
L’église possédait alors deux portes : la porte méridionale donnait accès au prieuré, et la porte occidentale était la porte d’entrée principale. Celle-ci fut endommagée au XIVème siècle lorsqu’on ajouta un porche. Au début du XIXème siècle, le porche fut converti en chapelle, ce qui imposa le déplacement du portail.
En 1372, la seigneurie de Rieux fut acquise par une famille originaire du Limousin, les La Juigie.
Une chronique de 1397 nous apprend que Guillaume de La Jugie-Puydeval fit creuser, sous la pile sud du sanctuaire, une chapelle souterraine dédiée à Sainte Madeleine.
En 1512, Tristan de La Jugie-Morèze fit construire la chapelle des Seigneurs sous l’invocation des Saints Germain, Joseph et Michel.
L’église fut restaurée après 1840 par l’architecte départemental Champagne. L’opération engendra de nombreuses contestations. L’architecte Charles-Auguste Questel vint contrôler le monument, et fit un rapport critique daté de 1844.
Eugène Viollet-le-Duc fut mandaté à Rieux pour examiner les travaux faits et proposer ceux qu’il serait urgent d’exécuter. Son rapport du 31 décembre 1844 fut très critique sur ce qui avait été fait : « il est très difficile de croire à cet acte de vandalisme lorsqu’on ne l’a pas vu. »
Par ailleurs, Prosper Mérimée affirma que le ministre avait souhaité ramener l’église dans son plan ancien ; mais comme cela aurait entraîné la démolition des chapelles, ce projet fut abandonné. Dans son rapport de 1844, Viollet-le-Duc écrivit qu’on ne pourrait rétablir l’église dans son état ancien qu’en construisant une nouvelle église. Le coût élevé d’un tel chantier fut rédhibitoire, et le projet fut définitivement rejeté.
Afin d’augmenter le nombre de fidèles, on construisit au-dessus des bas-côtés une tribune sur poteaux en fer, qui fut supprimée en 1968.
Le 8 septembre 1918, à la suite d’un orage, le clocher s’effondra. Il fut reconstruit en simplifiant l’ancien modèle.
L’église et ses abords furent inscrits au titre des sites naturels en 1943.

L’ÉGLISE DE L’ASSOMPTION DE NOTRE-DAME
L’édifice est une rotonde construite sur un plan heptagonal (chœur à 7 côtés et déambulatoire à 14 côtés aux angles peu marqués, soulignés par un pilier de moyenne hauteur surmonté d’un chapiteau).
Les chapiteaux finement ouvragés (notamment celui de la Vierge en Gloire) sont l’œuvre d’un sculpteur anonyme dit « Maître de Cabestany », et de son école.

Chapiteau de l’Assomption de la Vierge œuvre attribuée au Maître de Cabestany
Certains érudits pensent qu’il peut-être aussi le concepteur de cette rotonde où le chiffre sacré 7 est omniprésent. Elle a été classée Monument Historique en 1838.
A l’origine, il n’y avait pas de chapelles ; elles ont été créées vers le XVème siècle pour les premières ; d’autres ont été rajoutées par la suite. L’entrée principale d’origine se situe dans la chapelle de l’orgue, où l’on peut admirer de superbes sculptures.
Le clocher massif, lui aussi à 7 côtés, surmonte la coupole. L’éclairage de nuit le met en valeur et fait ressortir sa masse imposante.
On sait peu de choses sur ce maître sculpteur anonyme de la seconde moitié XIIème siècle. D’où venait-il ? Etait-il un homme d’église ? Comment apporter une chronologie à son immense œuvre artistique ? Pourquoi est-il allé en Toscane et en Navarre ? Avait-il des élèves ou bien travaillait-il seul ? Toutes ces questions restent encore sans réponse satisfaisante aujourd’hui. L’homme et son œuvre restent un mystère. L’association de plusieurs de ses sculptures, remarquables par leur style (on cite par exemple « le tympan de Cabestany »), lui a valu le nom de « Maître de Cabestany ». Ces dernières sont pour la plupart recensées dans les départements actuels de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, et dans le nord de la Catalogne ; mais on a aussi reconnu la touche de l’artiste en Toscane et en Navarre.
Lire :
– l’abbaye de Saint-Hilaire. L’église abbatiale abrite un sarcophage dit sarcophage de Saint Saturnin (ou Saint Sernin). Il est l’œuvre du maître de Cabestany.
– l’abbaye Sainte Marie de Lagrasse. L’abbaye abrite une exposition lapidaire du Maître de Cabestany.
– l’abbaye de Saint Papoul. L’abbaye abrite une exposition lapidaire du Maître de Cabestany.
– l’abbaye de Caunes-Minervois. L’abbaye abrite une exposition lapidaire du Maître de Cabestany.
L’église de Rieux-Minervois fait partie du groupe des rotondes à collatéral circulaire, comme l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Saint-Vital de Ravenne, la chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle, Saint-Bénigne de Dijon (construite par Guillaume de Volpiano, dont il subsiste la crypte), l’église de Neuvy-Saint-Sépulchre, et l’abbatiale de Charroux…
L’église fut construite suivant un plan centré de rotonde de 7 côtés dans sa partie centrale, couverte d’une coupole à sept pans, et entourée d’un déambulatoire de 14 côtés. La poussée de la coupole est contrebutée par une voûte en quart de cercle qui recouvre le déambulatoire.
Cette forme heptagonale est unique au monde. Le chiffre 7 est le symbole de la sagesse divine à laquelle est assimilée la Vierge Marie. Une « Mandorle » représentant l’Assomption de la Vierge Marie (une des nombreuses sculptures attribuées au Maître de Cabestany) est présente dans le sanctuaire.

EXTÉRIEUR
L’ENTRÉE
LES FAÇADES

INTÉRIEUR
LA ROTONDE
LE CHŒUR
LA COUPOLE
LES CHAPITEAUX ET LES COLONNES
LES CHAPELLES
LES STATUES
L’ORGUE
LES VITRAUX

Sources :
Mes photos
Photos publiques Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rieux-Minervois#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rieux-Minervois
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_de_l%27Assomption_de_Rieux-Minervois
http://belcikowski.org/publications/?p=3681
https://fr.aroundus.com/p/10433669-eglise-de-lassomption-de-rieux-minervois